тишина

«Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer Ana à Saint-Pétersbourg. Elle avance dans une rue glaciale, sa peau est retournée, mais le froid passe à côté, parce que toute son attention est à l'intérieur. Ana cherche à comprendre Gor, Ana veut devenir Gor.»
La narratrice de ce roman, enquêtant sur un poète russe méconnu, Guennadi Gor – auteur du recueil Blocus lors du siège de Leningrad –, s'aperçoit qu'Ana, une étudiante portugaise qui s'était passionnée dix ans auparavant pour le même poète, a disparu aux confins de la Biélorussie, non sans laisser à son tour des carnets intimes. Revenant sur les pas de ces écrits successifs, elle s'imprègne peu à peu de leurs destins, où résonne plus d'un demi-siècle d'histoire européenne, pour tracer sa propre ligne de fuite.



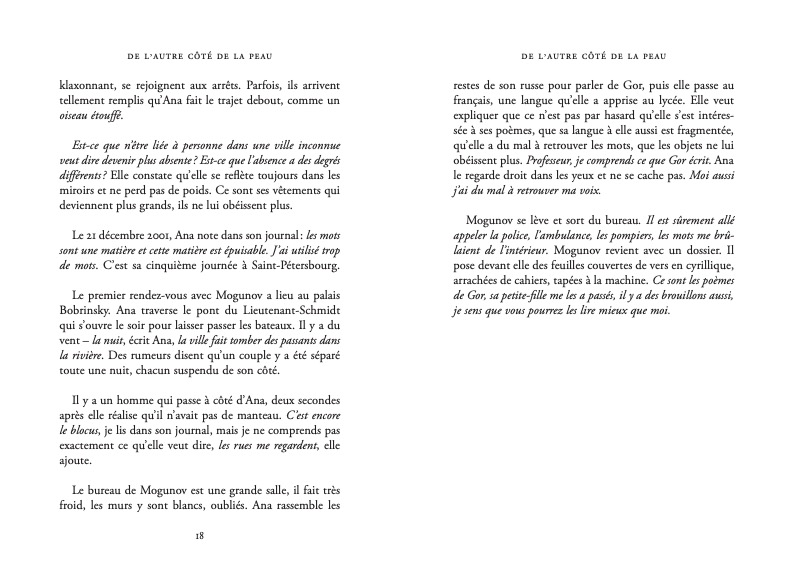
Bourse Région Nouvelle Aquitaine
Un extrait du roman (Alca Nouvelle Aquitaine, création sonore “Octave sonore”)
Dessin animé par Mary Shalynina, voix off par auteure